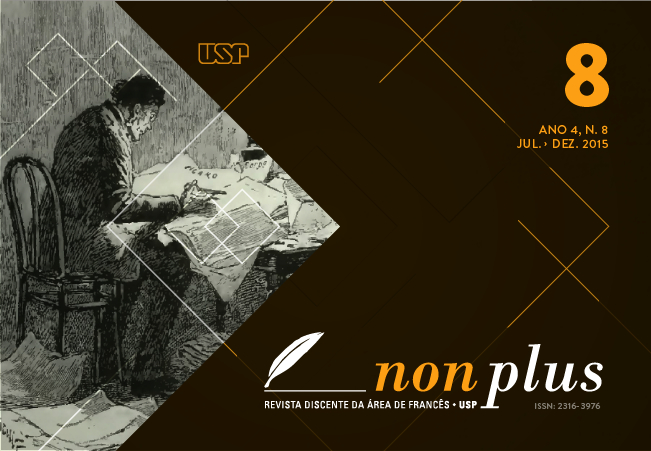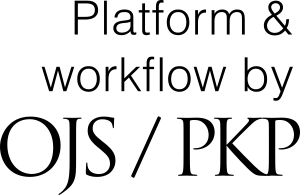LE CINEMA COMME DISPOSITIF DE REPRESENTATION DANS IL FAUT AIMER LES HOMMES DE MARIE DARRIEUSSECQ
DOI :
https://doi.org/10.11606/issn.2316-3976.v4i8p93-108Mots-clés :
Cinéma, dispositif de représentation, Hypotypose, nouvelle cinéphilie, minorités collectives.Résumé
S’inscrivant dans le sillage des interactions nouvelles suscitées par l’époque contemporaine entre le réel et la représentation, l’article se charge de montrer que la pensée cinématographique informant et transformant le roman de Marie Darrieussecq est le fruit de l’hypotypose, une technique chargée de mettre en évidence le travail de mise en scène du réalisateur et celui des acteurs. L’expérience critique qui s’y développe repose sur la condamnation de certaines pratiques hollywoodiennes et la promotion d’une nouvelle cinéphilie engagée résolument à protéger les minorités collectives. La notion de dispositif acquiert ainsi tout son sens en ce sens que Darrieussecq parvient à faire arrimer ou coïncider organisation géométrale (ce qui est disposé devant le lecteur/spectateur) et organisation symbolique (le sens de l’image), nécessaires à l’ordonnancement de la représentation.
##plugins.themes.default.displayStats.downloads##
Références
APPADURAI, A. Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation.
Paris : Payot, 2001.
BRISELANCE, M-F., MORIN, J-C. Grammaire du cinéma. Paris : Nouveau
Monde éditions, 2010.
CLÉDER, J. Entre littérature et cinéma. Les affinités électives (échanges, conversions,
hybridations). Paris : Armand Colin, 2012.
COLLÈS, L. Littérature comparée et reconnaissance interculturelle. Bruxelles/ De Boeck-
Duculot, 1994.
DARRIEUSSECQ, M. Il faut beaucoup aimer les hommes. Paris : POL, 2013.
GARDIES, A. L’espace au cinéma. Paris : Méridiens Klincksieck, 1993.
LAMY, B. La Rhétorique ou l’art de parler. Paris: PUF, 1998.
LIPOVETSKY, G., SERROY, J. L’écran global. Du cinéma au smartphone. Paris : Seuil,
LOJKINE, S. « Le dispositif : une réalité et un enjeu contemporains » : Disponible à
www.univ- montp3.fr. Accès à : 3 Juin 2015.
LOUVEL, L. Le tiers pictural. Pour une critique intermédiale. Rennes : PUR, 2010.
PROTAT, Z. « La direction d’acteur : jouer de confiance », Ciné-Bulles, vol. 29, n° 1, 2011,
pp. 38-41.
[S.A.], « L’acteur et le réalisme », Séquences : la revue de cinéma, n° 19, 1959, pp. 11-14 :
Disponible à http://id.erudit.org/iderudit/52152ac. Accès à: 3 Juin 2015.
ROY, A. « Cinéma et engagement – 1 », 24 images, n° 92, 1998, pp. 6-8.
SKORECKI, L. Raoul Walsh et moi suivi de Contre la nouvelle cinéphilie. Paris : PUF, 2001.
VISWANATHAN J. « Une écriture cinématographique ? », Études littéraires, vol. 26,
n°2, 1998, pp. 9-18.
WAGNER, F., Entretien avec Jean Cléder à propos de son ouvrage Entre littérature et
cinéma. Les affinités électives (échanges, conversions, hybridations). Paris :
Armand Colin, 2012. Entretien publié le 25/03/2013 : Disponible sur
vox-poetica.org. Accès à : 12 janvier 2015.
Téléchargements
Publiée
Numéro
Rubrique
Licence
En soumettant le matériel pour la publication, l'auteur déclare automatiquement qu’il est l’auteur de son travail. Il assume toute responsabilité devant la loi numéro 9.610, du 19 février 1998. Dans le cas de plagiat ou de diffamation, il s’oblige à répondre pour l'originalité de l’œuvre, y compris les citations, les transcriptions, l’utilisation de noms de personnes et de lieux, de références historiques et bibliographiques et tout ce qui a été incorporé dans son texte, exemptant l'équipe de la Revue Non Plus, ainsi que les institutions qui lui sont liées. L'auteur reste le seul propriétaire des droits de son texte, mais autorise l’équipe de la Revue Non Plus à le réviser, l’éditer et le publier, en suggérant (et ou effectuant) des modifications si nécessaire.
L'auteur déclare que son texte n’est pas objet de charge de la preuve d'aucune sorte, ainsi qu’il n’existent pas de contrats éditoriaux en vigueur qui empêchent sa publication sur la Revue Non Plus, étant le seul responsable de créances futures et d'éventuels dommages. Les originaux soumis doivent être inédits et ne doivent pas être soumis à une autre revue (s) pendant le processus d'évaluation.
En cas de coauteur, il est nécessaire une déclaration du coauteur (ou des coauteurs) autorisant la publication du texte.
Il est entendu, ainsi, qu’avec l'acte de soumission de tout matériel pour la Revue Non Plus, que l’auteur a pleine conformité avec les présentes conditions et les normes pour la préparation et la soumission de travaux. Le non respect de ces éléments ou des directives aux auteurs entraînera le rejet du matériel soumis à la publication.